


Qui etait le vrai Makaveli?
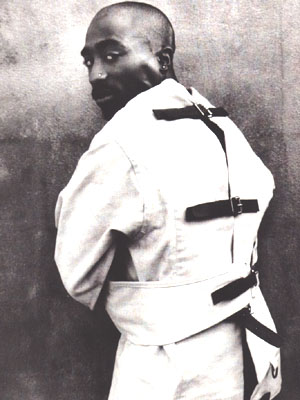

Machiavel Niccolò Machiaveli
Écrivain, philosophe et homme politique italien (Florence 1469 -
id. 1527).
Aujourd'hui légitimement tenue pour fondatrice de la pensée
politique moderne, son œuvre la plus célèbre, Le Prince, publiée
après sa mort, fit l'objet, dès le XVIe siècle, de nombreux
commentaires et prises de position. Elle suscita l'invention du
terme machiavélisme, désignant l'attitude systématique de ruse et
de mauvaise foi dans la conduite des affaires publiques et privées ;
imputation pour une large part injuste.
D'origine modeste, Machiavel fait des études littéraires et
juridiques dans sa ville natale. Après le départ des Médicis ,
chassés par la défaite de leurs alliés espagnols et la chute du
"prophète désarmé " Savonarole, il obtient, par concours, un poste
de haut fonctionnaire dans la République florentine. Il y excelle, se
voit chargé de missions diplomatiques, notamment à Rome et en
France, et s'occupe de l'organisation de l'armée. La défaite
française ramène les Médicis à Florence : Machiavel est révoqué,
un moment incarcéré, puis définitivement écarté des charges
publiques. La dédicace de son livre Le Prince à Laurent II de
Médicis, en 1513, n'est d'aucun effet, pas plus que ses Discours
sur la première décade de Tite-Live, achevés en 1520, ou son
Art de la guerre (1521). Il finit sa vie en quasi-exil aux environs
de Florence, dans une sérénité relative.
On ne sait ce qu'il faut le plus admirer dans son œuvre : la fermeté
et l'unité de son projet, l' habileté dont il use pour le défendre,
mêlant dans son argumentation la déduction conceptuelle à
l'exemple contemporain et aux enseignements de l'histoire
romaine, ou l'originalité de l'entreprise. Machiavel ouvre la
réflexion politique sur une perspective radicalement nouvelle et le
contenu de ses analyses définit, pour la première fois, le champ
autonome du politique.
L'institution du politique
Jusqu'alors, dans l'histoire de la culture méditerranéo-européenne,
la pensée du politique était en quelque sorte tributaire de
conceptions plus larges - la philosophie ou la théologie (ou, plus
directement, les leçons des textes sacrés). Platon, Aristote,
Thomas d'Aquin déduisaient le bon régime de leur théorie de
l'Être tandis que saint Augustin et saint Bernard s'appuyaient sur
les Écritures.
Machiavel, lui, comprend l'ordre politique comme le résultat d'une
volonté instauratrice. Analysant la fondation de Rome selon
Tite-Live, il souligne que la ville n'existe, et avec elle la civilisation
romaine, qu'en raison et à cause de la décision de Romulus, qui
institue, dès lors, un commencement absolu. L'acte qui donne
l'être est celui d'un législateur qui décide et fonde. C'est cet acte
qui doit être maintenu et sans cesse réitéré par les pouvoirs qui se
succéderont. S'intéressant non à une république (Le Prince), mais
aux principautés, le conseiller florentin insiste de la même manière
sur le fait que la socialité dite naturelle ne fait pas l'État,
c'est-à-dire le pouvoir central souverain. Pour qu'il y ait principat,
il est nécessaire qu'une volonté s'impose sans partage et incarne la
puissance de la collectivité. Cette idée force détermine la suite de
son propos. Bien qu'ils aient prétendu s'opposer à Machiavel,
Jean Bodin, Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau la
reprennent, chacun à sa manière : la souveraineté qui fait exister
l'ordre intérieur et la puissance tournée vers l'extérieur ne se déduit
pas, elle se pose. Il n'y a pas à la fonder, puisqu'elle est
fondatrice.
La séparation de l'État et de l'idéal
éthique
Ainsi se trouvent récusées les deux approches principales qui
avaient eu cours par le passé pour définir la bonne politique (et la
bonne Constitution). Celle héritée des Anciens, qui recherche
dans la socialité " naturelle " le secret de l'organisation
convenable ; celle abusivement déduite de saint Paul, qui s'attache
à formuler des lois humaines en accord avec les lois divines. La
politique n'est pas un savoir : elle se confond avec le pouvoir,
c'est-à-dire avec l'exercice de la puissance. Elle n'a rien à voir
avec la morale, qui concerne les affaires privées, puisque c'est la
politique qui décrète ce qui, dans le domaine public, est juste ou
injuste. La souveraineté - celle d'un individu, d'un groupe ou du
peuple - est, par définition, absolue et invisible : elle ne vaut
qu'autant qu'elle assure le bonheur, la cohésion et la gloire de la
collectivité.
Le nom de Machiavel reste ainsi attaché au souci d'instaurer une
nette séparation entre éthique et politique. Il met en doute qu'il soit
possible de combiner une conception de la vie chrétienne, fondée
sur l'humilité et le sacrifice de soi, avec la capacité de bâtir une
république puissante et illustre. À ses yeux, celle-ci exige plutôt,
pour durer, les vertus païennes du courage, de la vitalité, de
l'affirmation de soi. Concernant les gouvernants, une disposition à
l'action impitoyable, dénuée de scrupules, voire cruelle, est requise
lorsque l'exige la raison d'État. Le prince saura user de la ruse et
de la violence si le salut de la chose publique l'impose : autant de
qualités que Machiavel résume sous le terme de virtù. Le calcul y
entre pour une part essentielle : la politique étant aussi du ressort
de la fortune (de la chance), le prince doit calculer constamment
afin d'infléchir celle-ci dans le sens de son projet. Par cet aspect
de sa pensée, Machiavel aura une certaine influence sur Frédéric
le Grand, qui prit la peine de publier une réfutation de ses théories,
et, plus tard, au sein de la philosophie moderne, sur Friedrich
Nietzsche et ses disciples.
Machiavel combat la papauté romaine à qui il reproche d'user de
la force tout en se prévalant de la religion. Ses œuvres furent
d'ailleurs taxées d'immoralité et condamnées par l' Église. Il
appelle les princes italiens à renoncer aux troupes mercenaires et
voit dans les armées nationales le premier moment d'une marche
vers l'unification du pays, qui chasserait les " barbares " étrangers,
Français et Espagnols.
Machiavel était-il " machiavélique " ? Plus simplement, on peut
voir en lui un réaliste - un penseur qui a pensé et dit ce qui se fait
dans la réalité du jeu politique. Et qui, du coup, a dévoilé un
aspect fondamental de l'existence sociale moderne : le poids du
pouvoir d'État et de la violence qu'il exerce. Autant de thèmes que
l'on retrouve dans son œuvre littéraire, car Machiavel exerça aussi
une activité variée d'homme de lettres, s'affirmant comme un
écrivain et un artiste aux qualités exceptionnelles, auteur de
poèmes, de nouvelles, de pièces de théâtre. Son chef-d'œuvre,
dans ce domaine, reste La Mandragore (1518), en cinq actes,
l'une de ses principales comédies avec Clizia et Andria, toutes
tirées de modèles classiques mais situées à Florence dans les
années où vivait leur auteur, ces années tourmentées et tragiques
des Guerres d'Italie.
Portrait du philosophe italien peint par Santi de Tito. Palazzo Vecchio, Florence.
Ph. (c) IGDA
La biographie de Makaveli provient de l'Encyclopédie Edition Atlas.
©1998, Editions Atlas. Tous droits réservés.
Makaveli
warzâCdm2001